
Frères & sœurs : les clés de l’équilibre
Psychologies, juin 2025
les articles et tribunes parus dans la presse autour de mon travail

Psychologies, juin 2025

Prima, juin 2025
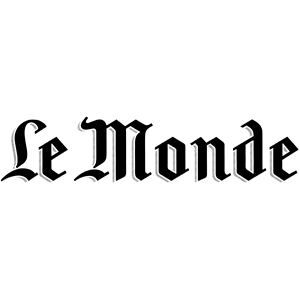
Le Monde, 20 mai 2025

Le Point, 17 mai 2025

Femme Actuelle, mai 2025

Nouvel Obs, 4 mai 2025
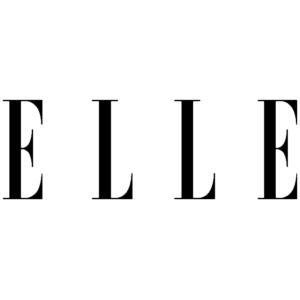
Elle.fr, mai 2025

Famille & Éducation, mai-juin 2025

Gala, 30 avril 2025

La Vie, 24 avril 2025