
Féminin/Masculin, comment les modèles se transmettent et se renforcent dans les relations de couple et de famille ? Comment faire évoluer les stéréotypes qui sont à l’origine de nombreuses souffrances ?
Conférence donnée à Lorient, mars 2018
les publications que j’ai écrites ou cosignées, à l’attention des professionnels

Conférence donnée à Lorient, mars 2018

La lettre du psychiatre, vol XIII, n°6, nov-dec- 2017

Les Cahiers de la banque du Luxembourg

Réalités Familiales n°118,119 « Familles & argent », juillet 2017

intervention au colloque 2017 de l'ANCCEF

Hypnose & thérapies brèves n°44 - février-mars-avril 2017

La lettre du Psychiatre, décembre 2013
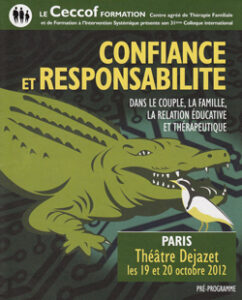
Mon intervention au colloque 2012 du Ceccof.

Intervention au colloque de l’Association Socio-éducative des Yvelines (ASSOEDY), mai 2011.

Réalités Pédiatriques n°163, octobre 2011