
Les nouvelles formes de filiation
Introduction au colloque 2009 du Ceccof, par Nicole Prieur
les publications que j’ai écrites ou cosignées, à l’attention des professionnels

Introduction au colloque 2009 du Ceccof, par Nicole Prieur

co-écrit avec Violaine Godart - colloque "L'enfant et la médiation familiale" - Paris, juin 2009.

co-écrit avec B. Prieur, dans "Thérapie Familiale" - Genève, 2008

Cahiers critiques de thérapie familiale N° 38 (2007)

Recherches et succès cliniques de l’hypnose contemporaine, sous la direction de C. Virot (Le Souffle d’or, 2007).

co-écrit avec Bernard Prieur, paru dans "Cahiers critiques de thérapie familiale" N°38. "De génération en génération, quelle transmission ?" en 2007

La Note Bleue - "Hypnose et thérapie brève" - sous la direction de D. Megglé. Ed. Satas 2005

co-écrit avec Bernard Prieur dans Psychiatrie Française - déc. 2005 - « Les conférences de Lamoignon »
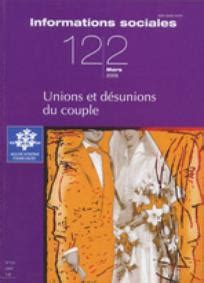
Informations sociales n°122, mars 2005.